|
|
|
| |
| |
 |
|
| |
.Hiroko Govaers, entretien et réflexions |
| |
 |
| |
|
| |
| Nouvelle Vague Japonaise
: Terayama & Co |
• Vous avez beaucoup côtoyé
les cinéastes de la Nouvelle Vague. Pourriez
vous nous retracer leur parcours ?
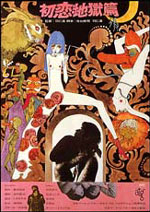 hatsukoi
jigokuhen - hani (1968)
hatsukoi
jigokuhen - hani (1968) |
A l’heure actuelle, il n’y
a pratiquement plus de films de studio, et la plupart
des réalisateurs travaillent de façon indépendante.
Mais à l’époque, la plupart des salles
d’exploitation au Japon étaient contrôlées
par de grandes compagnies : La Toho, La Daei (qui a disparu),
la Shochiku, et la Toei, qui y diffusaient les films qu’elles
produisaient. Pour entrer dans une Major de cinéma,
il fallait passer un concours d’entrée pour
devenir assistant réalisateur, après avoir
été diplômé de l’université.
Ca n’est pas du tout comme en France où on
commençait à travailler bien avant 18 ans
en tant que stagiaire, ou coursier, avant de devenir membre
de l’équipe technique. Les réalisateurs
de la Nouvelle vague, et même les plus anciens,
ont au moins un niveau maîtrise. Ce n’est
souvent qu’au bout de 10 ans que les grandes compagnies
donnaient aux assistants réalisateurs une chance
de réaliser un film. Prenons l’exemple d’Oshima.
Il est entre comme assistant à la Shochiku. En
1959, il a eu l’opportunité de réaliser
son premier film, et a débuté sa carrière
avec le Quartier de l’amour et de l’espoir,
puis a réalisé 2 ou 3 films pour la Shochiku.
En 1960, il a sorti Nuit et Brouillard du Japon, film
politique et anti-establishment, à une époque
où il y avait beaucoup de manifestations étudiantes,
et à cause duquel la Shochiku l’a limogé.
C’est comme cela qu’il est devenu indépendant.
Yoshida et Shinoda, qui eux aussi étaient à
la Shochiku, ont connu le même parcourt. Le cas
de Hani est différent, parce qu’il était
un enfant de bonne famille. Son père était
écrivain et éducateur connu a l’époque.
Il a commence à faire des courts métrages
et des documentaires de sa propre poche (enfin celle de
ses parents…). C’est comme ça qu’il
est devenu réalisateur. Ce sont ces gens là
qu’on appelle au Japon la “Shochiku Nouvelle
vague ”.
• Vous étiez très
proche de Shuji Terayama. Pouvez vous nous raconter
comment l’avez vous connu et comment ce cinéaste
singulier fut reçu et compris en occident ?
Terayama a lui un parcours complètement différent,
et est arrivé beaucoup plus tard en tant que
cinéaste. En 1966, il était déjà
connu en tant que poète dans un style traditionnel
japonais, pour lesquels il a obtenu quelques prix littéraires.
Il était surtout un homme de théâtre.
C’est à cette époque qu’il
a fondé ce qu’on appelle Tenjo Sajiki,
c’est à dire le Laboratoire de Théâtre.
Tenjo Sajiki signifie les sièges les plus hauts
du théâtre, c’est la traduction japonaise
du film les “ Enfants du Paradis ”. Il était
le chef de cette troupe théâtrale, écrivait
les pièces, et les mettait en scène. Lors
des représentations, il faisait jouer ses acteurs,
mais faisait aussi participer le public. “ Toi,
vient ici, monte sur la scène ! ” était
tout à fait son style. Coté carrière
cinématographique, il a réalisé
l’empereur Tomato Ketchup, un court métrage,
en 1970, avant de se lancer dans son premier long métrage
: Jetons les livres, sortons dans la rue en 1971. Comme
son titre l’indique, Il s’agit d’un
film contestataire : “ Cassons et brisons tout
”.Il a ensuite réalisé Cache Cache
Pastoral en 1974, puis deux autres longs métrages,
dont Fruits de la passion, soit 4 au Total. Tous ces
films sont sortis à Paris, mais avec un public
limité.

Empereur Tomato Ketchup - 1970
|
 Cache
cache pastoral (1974)
Cache
cache pastoral (1974) |
Terayama était en tournée
en Europe avec son groupe théâtral quand
je l’ai rencontré. Il est passé
par Paris, ou il m’a été présenté.
Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café
du quartier latin. J’avais beaucoup aimé
le film Jetons les livres, sortons dans la rue. Il en
avait amené les bobines avec lui, et celles-ci
l’encombraient beaucoup dans sa chambre d’hôtel.
Il m’a dit qu’il ne savait pas comment le
montrer. Alors d’une part, j’ai programmé
le film Rue d’Ulm, et je l’ai proposé
au festival du film d’auteur de Bergame en Italie.
Le siège était à Bergame, mais
le festival était à Saint Remo. Je n’ai
pas pu m’y rendre moi-même parce qu’à
l’époque, j’avais deux enfants en
bas age, mais Terayama est allé défendre
le film, qui a eu le Grand prix, qui consistait en une
importe somme d’argent en lires italiennes (quelques
millions), enveloppées dans du papier journal.
Terayama m’a été
reconnaissant, mais ça l’a surtout dépanné
: Sa troupe était composée de jeunes acteurs
autour desquels éclataient beaucoup de scandales.
Lors d’une représentation, un acteur est
descendu de la scène dans le public, et a mis
le feu à la jupe d’une des spectatrices.
La troupe a dû payer des dommages et intérêts
à cette dame avec cette somme d’argent
gagnée à Bergame. C’est à
cette époque que notre amitié est née,
et que j’ai commencé à m’occuper
de ses films. Vers la fin de sa vie - il est mort en
1983 -, je me suis aussi occupée de ses tournées
théâtrales en Europe et à New York,
etc. Notre collaboration a duré un peu plus de
10 ans.

Shuji
Terayama et Hiroko Govaers |
Les performances théâtrales
de Terayama n’ont été présentées
à Paris que beaucoup plus tard, sauf une expérience
dans les anciennes Halles de Paris qui étaient
fermées à cette époque, soit une
forme d’entrepôt délaissé.
Ca n’est que quelques mois avant son décès
qu’une de ses pièces a pu être présentée
dans la capitale française. J’ai mis plusieurs
années à essayer de convaincre le Festival
d’Automne, qui finissait toujours par refuser
en dernière minute. C’est finalement en
automne 1982 que Terayama a pu mettre en scène
Instructions aux Domestiques. Au niveau Européen,
la troupe de Terayama est souvent passée en Yougoslavie
grâce au festival de théâtre qui
s’appelait Bitterfull, ainsi qu’en Pologne,
et surtout Amsterdam, ou il y avait un théâtre
qui s’appelait Mickery, qui a fermé maintenant.
Le directeur qui s’appelle Ritsaern ten Cate,
était vraiment ouvert aux nouveaux spectacles,
jeunes talents, etc, et a présenté des
pièces de Tenjo Sajiki environ une fois par an
. Un jour, Terayama m’a demandé d’être
productrice déléguée pour son second
film Cache Cache pastoral. J’étais étonnée:
je n’avais aucune expérience dans le domaine,
même pas technique. Mais quand je lui ai dit,
il m’a répondu que de toute façon,
produire un film, c’était toujours comme
la première fois. C’est comme ça
qu j’ai signé en tant que productrice déléguée.
Anatole Dauman, de Argos film, avait été
le producteur de l’Empire des Sens de Oshima.
Comme il avait entendu parler de Terayama, il lui a
proposé de produire Fruits de la Passion, qui
est considéré comme le “ mauvais
film ” de Terayama. Là aussi j’ai
été désignée…je ne
sais pas quel titre j’ai sur l’écran…Disons,
producteur délégué.
 Dessin
de Terayama (Expo Shanghai 1981)
Dessin
de Terayama (Expo Shanghai 1981) |
Très souvent, même si je
ne suis pas tout à fait d’accord avec ces
propos, certains critiques japonais disaient que Terayama
était beaucoup plus connu à l’étranger
qu’au Japon. Ca n’est à mon avis
pas tout à fait exact parce qu’au Japon
comme en France, on retrouve le même type de public
d’initiés, vraiment intéressées
par ce genre de nouveautés et d’avant-gardisme,
complètement fidèles, véritablement
engagés en tant que spectateurs et pas du tout
le grand public. Leur accueil au théâtre
et aux films de Terayama a toujours été
très chaleureux. Le dernier film de Terayama
lui tenait vraiment à cœur. Il a presque
réussi à le réaliser, mais il était
presque au lit. On apportait le matelas pneumatique
sur le lieu de tournage, et il est décédé
quelques mois après. Encore maintenant, certains
metteurs en scène mettent en scène des
pièces de Terayama, et il y a des évènements
autour de sa personne chaque année, soit à
Tokyo, soit dans sa région natale au Nord du
Japon, notamment au mois de mai, qui est son mois de
décès. Ma collaboration avec Terayama
est allée plus loin que celle que j’ai
pu avoir avec Hani, Wakamatsu ou avec Oshima, ou les
autres cinéastes de cette génération,
où les relations sont restées professionnelles,
amicales et respectueuses. Avec Terayama, c’était
vraiment quelque chose de différent.
Propos
recueillis par Caroline Maufroid le 4 février
2006. Chaleureux remerciements à Mme Govaers.
|
|

|
|
|
